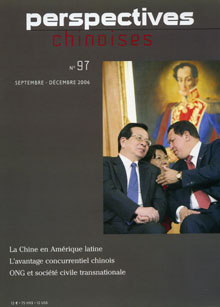
Perspectives chinoises 97
- Special Feature
- Article
- Book Reviews
Kjeld Erik Brodsgaard, Zheng Yongnian (éd.), The Chinese Communist Party in Reform
Daniel Bell, Beyond Liberal Democracy, Political Thinking for an East Asian Context
La Chine en Amérique latine
Pendant un demi-siècle la République populaire de Chine n'a porté qu'un intérêt limité à l'Amérique latine, une région où les Etats-Unis exerçaient une véritable hégémonie politique et économique. Cette époque d'indifférence est révolue. Depuis cinq ans, la Chine multiplie les investissements du Rio Grande à la Terre de feu et figure désormais parmi les premiers partenaires commerciaux du Brésil, de l'Argentine et du Chili. Cette présence suscite toutefois inquiétudes et interrogations tant en Amérique latine qu'aux Etats-Unis peu enthousiastes à l'idée de voir Pékin s'immiscer dans cette région. La Chine se heurte aussi aux ambitions de l'Inde, également préoccupée par son approvisionnement en matières premières.
L'avantage concurrentiel chinois : entre pratiques déloyales et avantages comparatifs
Pour s'emparer des marchés extérieurs, les industriels chinois sont capables de vendre leurs produits à des prix défiant toute concurrence. Grâce à un avantage comparatif décisif que nous appelons ici « l'avantage-prix de la Chine », ce pays détient déjà plus de 70% du marché mondial des DVD et de celui des jouets, plus de la moitié de ceux des vélos, des appareils photos, des chaussures et des téléphones, plus du tiers dans celui des climatiseurs, des télévisions couleur, des écrans d'ordinateurs, de la bagagerie et des fours à micro-ondes. Un certain nombre de facteurs-clés composant cet avantage-prix de la Chine ont été identifiés. Les plus significatifs seront présentés dans cette étude avec pour objectif d'en analyser la contribution respective. Ainsi, les coûts peu élevés du travail entrent à hauteur de 39% dans la composition de l'avantage-prix de la Chine. L'existence d'un système de production particulièrement efficace, organisé autour d'une tissu très dense de relations interfirmes, ainsi que des investissements directs étrangers (IDE) en pleine croissance, contribuent respectivement pour 16% et 3% dans la constitution de cet avantage-prix. Les autres facteurs de cet avantage-prix reposent sur ce que les concurrents étrangers appellent des pratiques commerciales déloyales, comme les subventions à l'exportation (17% de l'avantage-prix), la sous-évaluation de la monnaie (11%), la contrefaçon et le piratage (9%), et des normes réglementaires très peu contraignantes en matière d'environnement et d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail (5%).
ONG et société civile transnationale
La période qui va du début des années 1950 à la fin des années 1970 représente l'époque constitutive, militante, de la poésie moderne à Taïwan, qui s'écrit sous et contre l'ombre tutélaire de la poésie classique, qu'elle finit par remplacer dans l'attente du public. C'est la période où elle crée son langage et conquiert son espace, et au terme de laquelle elle prend sa place dans l'ensemble des activités culturelles contemporaines.
À une époque où, pour reprendre l'expression de Yü Kwang-chung 餘光中, « les poètes ne pouvaient pas ne pas s'allier », les revues, et les mouvements dont elles sont l'émanation ou le lieu de ralliement, jouent un rôle essentiel dans la réflexion sur la nature et le rôle de la poésie contemporaine, comme dans l'élaboration de sa langue. Chacune de ces revues, outre les poèmes qu'elle publie, les auteurs qu'elle présente, les traductions d'uvres étrangères qu'elle fait connaître, exprime des choix théoriques fortement marqués qui ont contribué à créer cet objet qu'on appelle désormais à Taïwan le poème moderne (現代詩 xiandaishi).
Réflexions sur la quête d'une identité nationale et culturelle en Chine
Cet article analyse les éléments fondamentaux de la constitution d'une identité culturelle et nationale en Chine depuis le XIXe siècle. Il examine également la situation depuis les années 1980 à travers différents thèmes : l'importance croissante du confucianisme, le rôle de l'histoire et de la langue ainsi que la réapparition d'auteurs occidentaux dans le débat intellectuel après le déclin du marxisme-léninisme. Enfin, il s'attache à replacer dans une perspective historique la question du nationalisme en Chine aujourd'hui.
Les mouvements poétiques à Taïwan des années 1950 à la fin des années 1970
La période qui va du début des années 1950 à la fin des années 1970 représente l'époque constitutive, militante, de la poésie moderne à Taïwan, qui s'écrit sous et contre l'ombre tutélaire de la poésie classique, qu'elle finit par remplacer dans l'attente du public. C'est la période où elle crée son langage et conquiert son espace, et au terme de laquelle elle prend sa place dans l'ensemble des activités culturelles contemporaines.
À une époque où, pour reprendre l'expression de Yü Kwang-chung 餘光中, « les poètes ne pouvaient pas ne pas s'allier », les revues, et les mouvements dont elles sont l'émanation ou le lieu de ralliement, jouent un rôle essentiel dans la réflexion sur la nature et le rôle de la poésie contemporaine, comme dans l'élaboration de sa langue. Chacune de ces revues, outre les poèmes qu'elle publie, les auteurs qu'elle présente, les traductions d'uvres étrangères qu'elle fait connaître, exprime des choix théoriques fortement marqués qui ont contribué à créer cet objet qu'on appelle désormais à Taïwan le poème moderne (現代詩 xiandaishi).
Barry Sautman, June Teufel Dreyer (éd.), Contemporary Tibet : Politics, Development and Society in a Disputed Region
Aurore Merle et Michaël Sztanke, Etudiants chinois, qui sont les élites de demain ?
Thomas David Dubois, The Sacred Village. Social Change and Religious Life in Rural North China
Elise Anne DeVido, Benoît Vermander (éd.), Creeds, Rites and Videotapes : Narrating Religious Experience in East Asia


